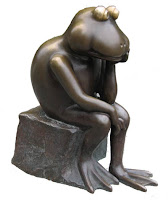Tout d’abord, je pense qu’il est important de définir un peu ce dont on parle, car, à défaut, on risque vite de s’embrouiller. Il faut dire que le sujet est riche en possibilités de confusions, conscience, volonté, destin, entre autres. La question du libre-arbitre, donc, est la suivante : est-ce que nous décidons de nos actions ?
Attention, c’est assez long, donc pour capter votre intérêt, je mets directement ma thèse. Pour moi, l’Homme est capable de prendre des décisions indépendantes des influences combinées de l’inné, les gènes, et de l’acquis[1], la société, l’éducation, ou encore l’expérience personnelle. Ces décisions peuvent être biaisées par ces influences, peuvent y être opposées, mais en tout cas n’y sont pas réductibles. Il est par ailleurs fondamentalement imprévisible, même si, là encore, le biais des influences peut être utilisé pour prévoir les comportements statistiques d’un grand nombre de personnes. Liberté de décision et imprévisibilité : l’Homme est doué de libre-arbitre, grâce au système complexe qu’est son cerveau.
Il faut d’abord évacuer une première confusion. Il est question ici de mon voisin, de la personne que je rencontre dans la rue, du collègue de bureau tel que je le vois tout les jours, personnes distinctes de moi-même, avec lesquelles j’interagis sans savoir s’il s’agit de robots androïdes à la Blade Runner, de corps pilotés par une âme ou un homoncule, ou autre chose. Le point est important, il s’agit d’un humain, et pas d’une entité supérieure omnisciente, qui regarde un autre humain.
Je voudrais ensuite préciser que « décider d’une action », ce n’est pas « réaliser une action ». Je peux décider de voler, et sauter du haut d’un toit, mais je n’en serai pas capable pour autant. Est-ce que
Forts de ces premières précisions, reformulons la question J’ai en face de moi un individu, placé devant un choix non-trivial, c’est-à-dire où plusieurs alternatives lui sont accessibles. Puis-je prévoir le choix qu’il fera ? Il peut être influencé par certains facteurs, l’influence de ses gènes, son histoire personnelle (incluant son éducation, les habitudes de la société qui l’entoure, ou encore ses expériences passées), tout le monde est d’accord là-dessus. Mais ces indications me donnent-elles la certitude de ce que va faire la personne ?
J’ai posé la question de façon non ambigüe. Si je ne suis pas capable de déterminer le choix de cette personne, quels que soient les moyens qui me soient donnés[2], alors elle a pris une décision autonome, elle a fait preuve de son libre-arbitre. Certains pourraient objecter que la personne n’a pas pris de décision, mais à simplement suivi une inclinaison naturelle, et à eu l’impression de prendre une décision. Mais si je ne suis pas capable, absolument pas capable, de prévoir cette décision, quelle différence cela ferait-il ? C’est ici que la confusion et l’ambigüité peuvent se glisser. Qu’est-ce que le libre-arbitre, si ce n’est la possibilité de décider de façon imprévisible ?
Il est possible, en schématisant un peu, de trouver plusieurs classes de personnes en fonction de leur réponse à cette question du libre-arbitre.
Les premiers sont ceux qui croient à l’existence d’une âme (ou d’un homoncule, cela revient au même bien qu’il n’y ait pas de connotation religieuse). Pour les membres de cette première catégorie, il existe quelque chose qui est réellement « moi », le corps humain n’étant qu’un habit, ou qu’un véhicule. Je pense que cette idée est assez naturelle, à première vue, puisque j’ai l’impression que mon moi réel commande à mes doigts d’écrire, commande à ma bouche d’avaler le jus de fruit dans le verre à côté de mon ordinateur… Mais cette conception dualiste peine à se concilier les neurosciences, qui montrent des activités bien spécifiques dans le cerveau lors de l’élaboration de ces ordres. Les philosophes, Descartes et Kant en particulier, nous ont aussi montré qu’il était assez vain de vouloir séparer le siège des décisions – quand bien même il s’agirait d’un organe, le cerveau – des organes des sens qui apporte les informations et de la peau qui forme une limite avec le monde extérieur. Le corps forme un tout.
Ensuite, parmi les matérialistes qui prennent pour acquis l’unicité de l’individu, il est encore possible de faire deux groupes. Le premier groupe est celui qui fréquente les commentaires chez Pikipoki : se réclamant de Spinoza[3] et des progrès de la science moderne, ils nient toute possibilité de libre-arbitre. Xavier, par exemple, écrit ceci :
Cela signifie aussi que nos actions sont totalement déterminées par notre patrimoine génétique d'une part et notre environnement de l'autre. Il n'y a rien d'autre, pas de "volonté" qui surgirait d'on ne sait où. Gènes + environnement = un seul résultat possible.
Penser que nous n’avons pas de libre-arbitre car le fonctionnement biologique du cerveau ne fait pas appel à de la magie ou une volonté supra-matérielle, c’est donner une autre définition au libre-arbitre que moi. C’est dire que le libre-arbitre est l’action de la volonté supra-naturelle. C’est excessif, et la définition du libre-arbitre comme étant la possibilité pour un individu de prendre une décision de manière imprévisible, est plus raisonnable.
Pour Xavier, Pikipoki et les autres commentateurs, « Prendre une décision » n’est qu’une illusion : les lois physiques, nos gènes, et d’autres facteurs externes, nous obligent à la prendre. Si je mange, c’est que j’ai faim, si je fais l’amour, c’est une pulsion (ou plutôt une subtile lutte d’influence entre mes gènes et l’influence de la société malthusienne dans laquelle j’ai grandi).
Ces personnes ont des arguments intéressants à faire valoir. Il y a bel et bien des influences très fortes qui s’exercent sur nos jugements. Nos gènes, via la façon dont notre corps est agencé, définissent une bonne partie de nos possibilités, réduisant d’autant nos choix accessibles. Via la production d’hormones à certains moments précis, ils contrôlent en partie notre comportement : pulsions, inhibitions, enthousiasme, panique… Ensuite, la société qui nous entoure, notre éducation, nos expériences personnelles, sont autant d’informations qui s’accumulent dans notre cerveau, et qui influencent nos décisions. Chat échaudé craint l’eau froide : voilà une bonne illustration.
Cependant, ces ultra-matérialistes sont ironiquement assez proches des dualistes, puisqu’ils s’appuient sur l’absence – a priori prouvée par les neurosciences – d’âme ou d’homoncule pour affirmer que le libre-arbitre d’existe pas. C’est-à-dire qu’ils pensent eux aussi que le moi indépendant devrait être extérieur au corps, et que s’il n’existe pas, alors nous ne sommes guère plus que des robots. En développant leur position, on se rend compte que les règles pilotant ces robots ont beau être compliquées, une technologie encore à découvrir devrait être capable de les comprendre, de les simuler, et de prévoir notre comportement.
Ce point de vue est faux. Le cerveau est un organe complexe. Complexe, ici, veut dire un peu plus que seulement « Houla, c’est compliqué ». S’il n’était que compliqué, comme l’est un ordinateur, une montre, ou un organe comme l’œil, le foie ou les muscles, une étude poussée permettrait d’en comprendre parfaitement le fonctionnement, et une technologie avancée permettrait de le simuler. Mais il est plus riche que cela : le grand nombre de neurones, le très grand nombre de connexions entre neurones, à la fois à courte et longue distance, à courte et longue durée (mémoire), leur possibilité de se réorganiser, leur interaction avec le reste du corps, fait que le fonctionnement n’est pas réductible aux neurones, et a fortiori aux molécules qui les composent ou qui les traversent.
Des motifs émergent des systèmes complexes : dans le cas du cerveau, on les appelle idées et décisions. La complexité est une notion fascinante, qui a plusieurs caractéristiques critiques dans le problème du libre-arbitre. La notion est présentée sur Wikipedia en français est ici. La version anglaise, pour une fois à peine plus complète, mais avec plus de liens, est ici. Si vous n’avez jamais entendu parler de la théorie de la complexité, je vous conseille de lire ces liens avant de poursuivre.
Tout d’abord, un système complexe n’est pas réductible : pour simplement décrire complètement l’état du cerveau avec à un instant t, il faudrait une bonne partie de l’univers parallèle offert par notre bon génie.
Ensuite, le grand nombre d’inconnues rend impossible la mise en équations du problème : écrire les équations occuperait le reste dudit univers parallèle.
Et quand bien même le (très aimable) génie fournirait les outils nécessaires à la simulation totale du corps (deux rappels : le corps entier doit être simulé, puisqu’il est en interaction avec le cerveau, et dans un système complexe, la moindre interaction peut avoir des conséquences énormes), cela ne fonctionnerait toujours pas. Tout simplement parce qu’une prédiction du comportement nécessiterait de simuler les chocs entre molécules : je vous passe l’argument de la puissance de calcul nécessaire, pour rappeler que ces chocs font appels à la physique quantique, irréductiblement probabiliste. Or, ce système n’est pas seulement complexe, il est aussi chaotique : la moindre imprécision de mesure peut faire échouer complètement une tentative de simulation. D’ailleurs, certains neurones fonctionnent de façon aléatoire, ce qui rend encore plus impossible la prévision, et approche peut-être une explication de ce que l’on appelle intuition ou coup de génie. Le cerveau est donc imprévisible dans l’absolu ; cela ne nie pas qu’en termes statistiques, les joueurs de poker et les publicitaires ne puissent pas faire des prévisions.
Il est temps de finir ce billet déjà trop long. Nous avons donc vu qu’à cause de la complexité du cerveau, il était foncièrement imprévisible. Je suis (et vous aussi, cher lecteur) donc un individu capable de prendre des décisions, de façon imprévisible. Certes, « je » n’est pas un être de volonté pure, désincarné, habitant mon corps. Certes, les pulsions et inhibitions de mon corps et de mes gènes, les habitudes de ma société, les exemples de mon éducation, m’influencent et me gouvernent parfois. Mais il reste que je suis capable de choisir, de peser différentes options et de choisir rationnellement, de me laisser porter par un coup de tête irrationnel, ou de choisir sciemment d’aller à l’encontre de tout ce que l’on peut prévoir sur moi, juste pour choquer. J’ai mon libre-arbitre, et vous aussi.
[2] Quand je parle de « tous les moyens », je veux dire que je pourrais demander à un bon génie de braquer des caméras ultra-rapides sur toutes les molécules de son corps, et de m’ouvrir un univers parallèles remplit d’ordinateurs quantiques pour faire tourner des simulations. Avec une telle débauche de moyens, je mérite au moins un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux, mais à défaut, je me contenterais de demander que l’on ne me sorte pas l’argument de la technologie qui pourrait s’améliorer dans le futur. Merci :-)
[3] Si j’ai bien compris l’extrait posté par Pikipoki, pour Spinoza, puisque nous pouvons rêver de prendre des décisions, alors les décisions que nous prenons quand nous sommes éveillés sont aussi des rêves. Je ne suis pas trop convaincu… Par contre, ça me motive pour m’intéresser de plus près à Spinoza.